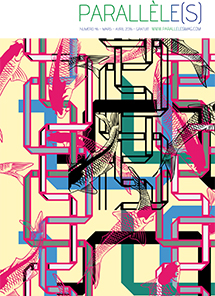GET ON UP
de Tate Taylor (Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis)

A croire que les biopics se sont donnés rendez-vous cette semaine, vu qu’outre « SAINT LAURENT », chroniqué plus bas, nous avons droit à la vie de « Mr Dynamite » himself, le « Godfather of Soul », James Brown, avec « GET ON UP » de Tate Taylor, produit par Mick Jagger.
Véritable fondateur du genre, confère Griffith et quelques autres, les américains n’eurent de cesse d’exposer leurs célébrités sur l’écran afin de consolider leur Histoire.
Lincoln, Custer, Malcolm X, Thomas Edison, Larry Flint, Davy Crockett, Mohammed Ali, Harvey Milk… La liste est fort longue.
Commençant lors de la déchéance de l’artiste, à la fin des années 80, où il avait viré dépressif entre drogue, alcool et possession illicite d’armes à feu, le long-métrage proposé enchaîne, certes, les flash-backs mais ne suit pourtant pas la linéarité narrative utilisée habituellement dans cet exercice.
Avec intelligence, nous passons au début du succès dans les fifties à la jeunesse pauvre de James Brown en Caroline du Sud avant de plonger au summum de sa gloire dans la période 60/70 puis de retourner dans son enfance, et ainsi de suite.
Tate Taylor, ici, n’essaie pas de faire preuve d’un quelconque militantisme au contraire de ce qu’il avait entrepris via « LA COULEUR DE SENTIMENTS », bien inoffensif, sur la ségrégation raciale. La personnalité de James Brown se suffit à elle-même.
Comme toujours, évidemment, le comédien principal choisi pour incarner le rôle titre dans un biopic est déterminant voire complémentaire quant à la tenue de l’ensemble.
Chadwick Boseman, quasi inconnu chez nous, spécialiste des rôles de sportif (baseball, foot) dans des productions inédites de ce côté-ci de l’Atlantique, est prodigieux.
De la gestuelle sur scène, de la voix (certains titres sont véritablement interprétés par lui, s’étant entrainé pour l’occasion), du physique, tout est ahurissant de mimétisme et d’un naturel inouï. Jamais l’on ne ressent la performance à tout crin, style « cool, j’vais avoir mon oscar » au contraire d’un Jamie Foxx dans « RAY ».
Ajoutons-y la reconstitution soignée des différentes époques abordées mais, me direz-vous, c’est la base.
Seul petit bémol, certains passages obligés, et légèrement fades, inhérents à la dramaturgie en vigueur chez l’Oncle Sam tel la scène de retrouvaille, après une brouille de quinze ans, entre James et son complice de toujours, Bobby Byrd, campé par Nelsan Ellis (le Lafayette de la série télé TRUE BLOOD).
Un bon biopic qui donne furieusement envie de réécouter, manu militari, le LIVE AT THE OLYMPIA , PARIS 71 de sa majesté Brown et de se sentir comme une SEX MACHINE.
LÉVIATHAN
de Andrey Zviaguintsev (Aleksei Serebryakov, Elena Lyadova, Roman Madianov)

Passer en fin de festival est à double tranchant : soit le film est une réussite, alors il a de sérieuses chances de se voir récompenser d’un prix, soit il est mauvais et la question est directement réglée, les gagnants seront ses prédécesseurs.
Ce fût le cas pour « LÉVIATHAN », projeté en Compétition Officielle sur la Croisette, cette année, remportant seulement le Prix du Scénario (alors que c’était la seule Palme d’or valable de tout l’ensemble).
Au nord de la Russie, près de la mer de Barents, Vadim Sergeyich, le maire d’une petite ville, tente de s’approprier le terrain (une maison plus un garage) de Kolya, un ancien para qui vit là avec sa jeune femme Lylia et son fils Romka, issu d’un précédent mariage. Ce dernier, pour se défendre légalement, fait appel à un ami, avocat à Moscou…
Cinéaste exigeant et souvent passionnant, déjà lauréat à Cannes d’un prix d’interprétation masculine (« LE BANNISSEMENT ») et d’un prix spécial du jury (« ELENA »), Zviaguintsev livre ici une critique hallucinante de noirceur du régime de Vladimir Poutine et de la corruption existante.
A l’aide d’une mise en scène, comme toujours chez lui, parfaitement maîtrisée et réfléchie, bénéficiant d’une interprétation sans faille de l’ensemble de ses comédiens, d’une justesse rare et d’un scénario sinueux qui pourra rebuter certains mais qui justement fait tout le sel de ce long métrage, il nous plonge au coeur des abîmes de l’âme humaine, avec parfois une solide dose d’humour (voir toutes les séquences de beuveries, dont une mémorable, lors d’un concours de tir en extérieur) contrebalancé derechef par une tonalité plus grave.
Et ce, pendant 2h20, sans faiblir.
Inexorablement, les différents protagonistes se dévoilent entre pathétisme absolu et quête d’une rédemption salvatrice illusoire.
Le nom de ce drame déroutant renvoie au cataclysme terrifiant capable de modifier la planète et d’en bousculer l’ordre et la géographie, à l’image exacte de ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, quelle que soit l’issue de le crise.
Un constat implacable.
Une oeuvre magistrale.
SAINT LAURENT
de Bertrand Bonello (Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux)

Après la version fort policée et commerciale de Jalil Lespert avec Pierre Niney de janvier dernier, voici la rivale, attendue, due à Bertrand Bonello, adepte d’un cinéma plus intimiste et cérébral.
Les années 1967/1976 d’Yves Saint Laurent, un des plus grands couturiers de tous les temps qui révolutionna la mode féminine, ses amours, ses rencontres, ses succès…
Allons-nous jouer au fameux jeu des comparaisons ?
Vous y tenez ?
Ok.
Pour la ressemblance et l’incarnation du maître de ces dames, Gaspard Ulliel, vainqueur par KO technique.
Pour Pierre Bergé, difficile de trancher tant, ici, il est quasi-inexistant et mal campé par Jérémie Renier. Mais comme l’interprétation de Guillaume Gallienne, adoubé par le principal intéressé, s’avérait trop angélique, match nul ou plutôt absence de match.
On va arrêter là et dire que Bonello, auteur notamment du respectable « LE PORNOGRAPHE » et du surestimé « L’APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE » en 2011, rate le coche avec une oeuvre ennuyeuse au possible, d’une consternante platitude malgré une ou deux scènes qui surnagent, et surtout une absence de point de vue malheureux.
Pourtant un véritable travail esthétique a été effectué. Cela se voit a l’écran mais n’est aucunement mis en valeur.
Les personnages secondaires (Léa Seydoux en tête) ne servent à rien et n’explicitent pas le caractère du génial créateur.
La cerise sur le gâteau est la propre apparition du metteur en scène à la fin, symbole d’un narcissisme propre, totalement vain.
Comme 90 % de ce « SAINT LAURENT ».
Le DVD de la semaine : « LE MARIAGE DE RAMUNTCHO »
de Max de Vaucorbeil / LCJ

1947, ce n’est pas que la victoire des USA, en finale de coupe Davis, face à l’Australie, la mort d’Al Capone ou la naissance de David Bowie.
Non.
1947, c’est surtout le premier film français en couleur !
« LE MARIAGE DE RAMUNTCHO ».
Ca tombe bien, ce dernier vient de bénéficier d’une sortie DVD chez LCJ.
Ramuntcho est un jeune homme qui vit de contrebande entre la France et l’Espagne. Véritable légende dans son domaine et idolâtré par tout le pays basque, il est également fin joueur de pelote. Maritchu, sa promise, vit avec sa grande soeur, une vieille fille, qui considère le passeur comme un bon à rien. L’arrivée de Georges, un séduisant et fameux peintre parisien va chambouler tout ce petit monde…
Adaptant un roman de l’immense Pierre Loti de 1897, qui connut d’autres transpositions, dont une jolie par Pierre Schoendoerffer, Max de Vaucorbeil (sur lequel je reviendrai un jour, c’est promis, car on ne peut pas laisser, de côté, l’homme responsable du sidérant « LA GARNISON AMOUREUSE » avec Fernandel) expérimente un procédé colorimétrique, inventé par les allemands, l’Agfacolor, qui a cette particularité de se délaver sous le poids des âges et de virer, parfois, verdâtre.
Une restauration a été entreprise par le CNC en 2000.
Heureusement, car la copie proposée, malgré une poignée de légères imperfections, rend justice au splendide travail effectué par Raymond Clunie, un directeur de la photo tombé dans l’oubli.
Sociologiquement intéressante, cette vision de Ramuntcho est à rapprocher de « CARMEN REVIENT AU PAYS » de Keisuke Kinoshita, premier film japonais en couleur, datant de 1951.
Dans les deux cas, une superbe exaltation du régionalisme et de la campagne qui bénéficie, présentement, de plusieurs séquences de chants originaux du pays, poussés par André Dassary, coqueluche basque de variétés et ténor lyrique, dans la défroque de notre héros contrebandier.
Il est entouré de l’italienne Gaby Sylvia (coprod oblige), actrice réputée de théâtre et de Franck Villard, sympathique moustachu excentrique que l’on vit beaucoup avec Gabin (exemple « LE CAVE SE REBIFFE ») et même dans « APOCALYPSE NOW » (Version Redux).
Symptomatique d’un passé où la joie de vivre et celle de tourner apparaissaient comme aller de soi, cette charmante comédie musicale, ne serait-ce qu’à ce titre, vaut largement le détour.