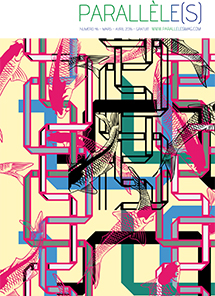Des Ambassadeurs aux Etats-Unis
Il a commencé la musique dans les années 70 et est devenu depuis un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine à travers le monde. Après avoir joué le folklore avec une guitare (« la musique n’était pas encore modernisée, la seule musique modernisée sur laquelle dansaient les gens étaient la salsa et certaines musiques occidentales »), il rejoint les Ambassadeurs en 1973 et se forme auprès de compositeurs qui se sont frottés à d’autres cultures. Il apprend à composer, à interpréter toutes sortes de musiques. Ami avec des politiques arrêtés par le pouvoir de l’époque, il fuit en Côte d’Ivoire en 1978. Il y découvre beaucoup d’influences occidentales et anglo-saxonnes. Sans instrument, il observe tout ça pendant un an. « La musique africaine, c’était pour les mariages ou les baptêmes. Mais je ne voulais pas faire comme les griots… » Après s’être bien imprégné de la culture ivoirienne, il enregistre son premier disque, qui lui permet de s’équiper en instruments. C’est la période où des musiciens de toutes les cultures se retrouvent à Abidjan, Manu Dibango est alors le chef d’orchestre de la RTI. Il part ensuite aux Etats-Unis grâce à un ami qui finance voyage et enregistrement de 2 disques. Il n’est pas dans l’optique de perpétuer la tradition, mais ses morceaux sont pour la plupart inspirés de la vie de tous les jours pour représenter les gens opprimés, discriminés, tous ceux qui n’ont pas droit à la parole.
Le retour en France
Il reste aux Etats-Unis jusqu’en 1985 et revient pour Musiques Métisses à Angoulême, un événement de cette période initié par Christian Mousset qui a permis de découvrir des tas de musiciens et de provoquer la grande vogue de la musique africaine dans les années 80-90 : « la musique africaine a énormément contribué à l’expansion de la culture africaine ».
Comment, de par votre origine, avez-vous persisté contre vents et marées dans la musique ? (Sélif Kéita cumulait 2 handicaps : celui d’être albinos et celui de venir d’une famille impériale, dans laquelle faire de la musique était méprisable).
Le modernisme est une trahison des générations par les générations. Quand tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Tu n’es pas obligé d’être archaïque, de rester collé à la tradition qui ferme les portes.
Mais l’enjeu était important…
Oui, c’était risqué. Dans l’ancien temps, j’aurais mérité la guillotine ! J’ai dit à mon père « je suis à l’école, j’ai des problèmes de vue, je ne peux pas continuer mes études ». Il ne pouvait pas m’envoyer aux champs, j’ai des problèmes de peau, je pouvais contracter des maladies. Il n’avait pas d’argent à me donner pour que je fasse du commerce. Et il fallait que je fasse des trucs nobles : ce n’est pas plus noble de faire de la musique plutôt que voler ?
Ce qui ne t’a pas empêché plus tard de faire un album-hommage à ton père
Bien sûr, plus tard on est devenus des amis. Quand il a vu des gens venir à la maison pour faire des documentaires sur moi, il a compris… Alors il m’a dit « je te laisse faire ça jusqu’à ce que tu aies un bon métier ». Et j’attends ce métier-là jusqu’à présent !
Tu as fait des concerts de soutien pour Mandela. Après sa disparition, penses-tu que cela puisse bousculer quelque chose géopolitiquement, en Afrique du sud et ailleurs ?
Personne ne peut échapper à la mort. On peut souhaiter vivre le plus longtemps possible, j’espère qu’il sera longtemps parmi nous. Mais je pense que des gens comme lui sont immortels, par ce qu’ils ont fait pour l’humanité. Même s’il part, plus on va s’éloigner de Mandela, plus on va penser à lui. Ce monsieur est comme un prophète, il est monté sur la cible de l’âme pas seulement par le fait des Africains, mais par celui du monde sensible, dans le monde entier.